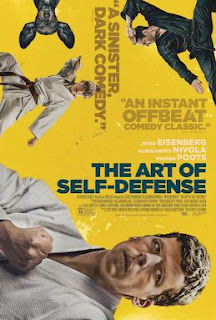Le cinéma français a narré maintes fois l'affrontement entre flics et voyous, sur tous les tons ou presque. Quand la frontière entre les deux camps devient poreuse, l'exercice de style peut donner de grands films dramatiques, ou les âmes s'entrechoquent. On pense évidemment au cinéma du grand Jean-Pierre Melville ou à celui, plus récent, d'Olivier Marchal, pour ne citer que deux exemples. Co-scénariste du très bon "L'affaire SK1", David Oelhoffen réalisa il y a peu "Frères ennemis", où s'affrontaient le flic et le truand, sur un territoire commun, la banlieue. On parla peu de ce film lors de sa sortie. Aurait-on du lui porter plus d'attention ?
 Alors qu'ils furent comme frères durant leur enfance, Manuel et Driss ont choisi, à l'âge adulte, deux chemins différents. Driss devint policier et travaille à démanteler les réseaux de trafics de drogue, là même où Manuel a opté pour l'autre côté du miroir, et vit de ces mêmes trafics.
Alors qu'ils furent comme frères durant leur enfance, Manuel et Driss ont choisi, à l'âge adulte, deux chemins différents. Driss devint policier et travaille à démanteler les réseaux de trafics de drogue, là même où Manuel a opté pour l'autre côté du miroir, et vit de ces mêmes trafics.
Les événements vont pousser les deux hommes à se retrouver, à se confronter et à affronter leurs valeurs : qui a raison ? Qui a tort ? Qui en sortira indemne ?
Comme le fit Melville autrefois, David Oelhoffen plonge sa caméra parmi les truands de la même façon qu'il explore la vie de policiers. A armes égales, les deux camps, séparés par une ligne plus poreuse qu'il n'y paraît, se frottent l'un à l'autre et la tension est palpable. Autant le dire tout de suite, la filiation que j'attribue à ce film est tout à son honneur : il y a longtemps qu'on n'avait pas vu un film noir français aussi convaincant et presque totalement réussi.
 Alors qu'ils furent comme frères durant leur enfance, Manuel et Driss ont choisi, à l'âge adulte, deux chemins différents. Driss devint policier et travaille à démanteler les réseaux de trafics de drogue, là même où Manuel a opté pour l'autre côté du miroir, et vit de ces mêmes trafics.
Alors qu'ils furent comme frères durant leur enfance, Manuel et Driss ont choisi, à l'âge adulte, deux chemins différents. Driss devint policier et travaille à démanteler les réseaux de trafics de drogue, là même où Manuel a opté pour l'autre côté du miroir, et vit de ces mêmes trafics.Les événements vont pousser les deux hommes à se retrouver, à se confronter et à affronter leurs valeurs : qui a raison ? Qui a tort ? Qui en sortira indemne ?
Comme le fit Melville autrefois, David Oelhoffen plonge sa caméra parmi les truands de la même façon qu'il explore la vie de policiers. A armes égales, les deux camps, séparés par une ligne plus poreuse qu'il n'y paraît, se frottent l'un à l'autre et la tension est palpable. Autant le dire tout de suite, la filiation que j'attribue à ce film est tout à son honneur : il y a longtemps qu'on n'avait pas vu un film noir français aussi convaincant et presque totalement réussi.
L'ambiance du film, portée par des acteurs inspirés, des décors réalistes et une photographie remarquable, est sans conteste son point fort. Rarement aura-t-on vu un film "de banlieue" (cette étiquette semble revenir en grâce, ces dernières années) aussi équilibré et réaliste. Le réalisateur, déjà remarqué pour son travail de coscénariste sur "L'affaire SK1", confirme l'essai : si vous êtes amateurs de films policiers où l'ambiance est du côté du réalisme, où les personnages sont dotés d'une vraie épaisseur et où les enjeux vont au-delà de la résolution de l'intrigue, vous serez comblés.
 Autre point fort de "frères ennemis" : son interprétation est remarquable. Reda Kateb et Mathias Schoenaerts, les deux piliers de cette tragédie à la fois classique et moderne, sont impériaux et prouvent, s'il en était besoin, leur talent (qui mériterait d'être plus souvent exploité et mieux reconnu, si vous voulez mon avis).
Autre point fort de "frères ennemis" : son interprétation est remarquable. Reda Kateb et Mathias Schoenaerts, les deux piliers de cette tragédie à la fois classique et moderne, sont impériaux et prouvent, s'il en était besoin, leur talent (qui mériterait d'être plus souvent exploité et mieux reconnu, si vous voulez mon avis).
 Autre point fort de "frères ennemis" : son interprétation est remarquable. Reda Kateb et Mathias Schoenaerts, les deux piliers de cette tragédie à la fois classique et moderne, sont impériaux et prouvent, s'il en était besoin, leur talent (qui mériterait d'être plus souvent exploité et mieux reconnu, si vous voulez mon avis).
Autre point fort de "frères ennemis" : son interprétation est remarquable. Reda Kateb et Mathias Schoenaerts, les deux piliers de cette tragédie à la fois classique et moderne, sont impériaux et prouvent, s'il en était besoin, leur talent (qui mériterait d'être plus souvent exploité et mieux reconnu, si vous voulez mon avis).
Le seul bémol qu'on pourra mettre à "Frères ennemis" est du côté de son scénario, un rien prévisible et manquant de surprises. Mais la destinée des deux frères ennemis du titre semble, hélas, tracée, et, dans le registre qu'il exploite, il n'est guère de place pour le suspense : on est ici dans un drame humain avant tout et ses protagonistes ont beau savoir qu'ils foncent droit dans le mur, ils n'ont d'autre choix que de poursuivre leur destin. Il est rarement de happy end, dans le film noir comme dans la vie réelle.
Moins clinquant qu'un film d'Olivier Marchal, plus réaliste et plus humain, "Frères ennemis" est une des meilleures choses qui soient arrivées, ces dernières années, au cinéma policier français. Avec un scénario plus solide, il aurait accédé au panthéon de ce genre.