Judge Dredd, comme certains autres personnages de comics, avait jusque là été bien mal traité par le cinéma. Déjà personnage central d'une adaptation où Sylvester Stallone lui prêtait ses traits, il avait laisssé un souvenir amer aux fans de l'oeuvre originale. A l'époque, le film souillait le héros, Sly se permettant même d'enlever l'emblématique casque du Juge le plus célèbre de Mega City One. Quand un reboot, qui plus est en 3D fut annoncé et que les rumeurs les plus folles coururent sur le compte de celui-ci (comme, par exemple, le fait qu'il soit mis en scène par Danny Boyle), on avait tout lieu de s'inquiéter. Au final, le destin du film fut tout aussi funeste, puisque "Dredd" (notez la sobriété du titre) fut un tel bide qu'il sortit directement sur le marché vidéo dans plusieurs pays, dont la France.
Pete Travis, réalisateur de "Dredd", a fait ses armes à la télévision, avant de réaliser "Angles d'attaque" et "Endgame", deux films qui donnaient déjà un aperçu de ses ambitions de mise en scène et de scénario. Son approche de "Dredd", bien que beaucoup plus classique d'un point de vue scénaristique, est, esthétiquement parlant, l'un des grands atouts du films. L'univers de "Dredd" est conforme à l'esprit de la BD d'origine : sale, corrompu, désespéré. Certes, on pourra déplorer l'usage abusif de la 3D, quitte à être taxé d'esprit chagrin.
.jpg)
Dans la peau du Juge Dredd, Karl Urban, déjà repéré en Eomer dans "Le Seigneur des Anneaux" ou dans "Pathfinder", parfaitement monolithique, obtient sans doute la son meilleur rôle depuis longtemps, aussi ingrat soit le costume du Juge. A ses côtés, la jeune Olivia Thirlby tire plutôt bien son épingle du jeu, dans un casting gorgé de testostérone.
Sur la forme, donc, rien à redire sur ce "Dredd", qui ravira les amateurs d'action et d'anticipation sombre (sur une partition musicale extrêmement bien fichue, soit dit en passant). Le fond n'est, heureusement, pas en reste. A l'instar des comics dont il est tiré, "Dredd" tend au spectateur un miroir à peine déformant où se reflètent les pires travers de notre société. Sans être un de ces films de science-fiction qui donnent matière à réflexion des années durant (ne nous leurrons pas, nous ne sommes pas devant "Blade Runner", non plus), les aventures du Juge Dredd évoquent le présent en décrivant un futur cauchemardesque.
Des pétitions circulent afin que soit produite une suite à "Dredd" : c'est sans doute la preuve (bien qu'elle arrive un peu tard) de la réussite de ce film. Une fois n'est pas coutume, en plus d'être justifié, le reboot est de loin supérieur à l'original.

.jpg)

.jpg)
.jpeg)




.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)

.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)


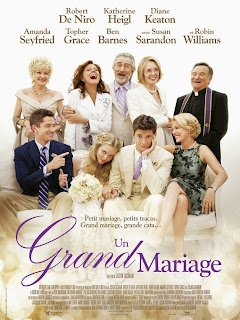
.jpg)
.jpg)


.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)

.jpg)



.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)

.jpg)
