Avec un casting solide et un thème dans son époque, "Hector et la recherche du bonheur" avait ses chances dans les salles obscures. Mais, à sa sortie, ce fut un four, au point que les spectateurs français durent attendre sa sortie en DVD pour le voir. Tiré d'un roman à succès, il s'agissait pourtant d'un film surfant sur l'air du temps : la recherche du bonheur, l'accomplissement de soi. Pourquoi n'a-t-il pas eu autant d'audience qu'espéré ?
Psychiatre londonien, Hector s'interroge : c'est quoi, le bonheur, après lequel se patients courent en vain ? Et lui, d'ailleurs ? Il a tout pour lui : un métier épanouissant, une femme ravissante, une vie bien remplie, mais, au fond, sait-il ce qu'est le bonheur ? Alors, du jour au lendemain, il prend son sac à dos et décide d'entreprendre un grand voyage à la recherche de ce qu'est le bonheur. De la Chine à l'Afrique en passant par les Etats-Unis et le Népal, Hector va aller à la rencontre des autres, de lui-même et, qui sait ?, du bonheur.
On songe à "La vie rêvée de Walter Mitty", en visionnant ce voyage initiatique aux quatre coins du globe, en regardant Hector faire ces rencontres enrichissantes (la plupart du temps) ou décevantes. Quand Hector remplit son journal de voyage, le ponctuant de maximes évidentes (de celles qui fleurissent ça et là, en ces temps où le développement personnel tient lieu de remède ultime), on se prend à espérer un film qui ferait du bien et le ferait joliment. Adapté d'un roman de François Lelord, le long métrage de Peter Chelsom ("Hannah Montana, le film" et "Potins mondains et amnésies partielles", par exemple) ne tient pas sa promesse, si tant est qu'il la fît. Lorsque cessent les pérégrinations d'Hector, on ne se sent pas mieux. Tout juste est on content que lui ait trouvé la paix de l'âme, ou plutôt la résignation.
 On pourrait aussi tiquer sur le choix des destinations d'Hector : atterrissant en Chine sans aucun problème, il se rend directement au Népal, par exemple. Quand on connaît la situation entre ces deux nations, on peut s'interroger : une étape de transition, dans le scénario, aurait été nécessaire, si vous voulez mon avis. De la même façon, lorsqu'Hector se retrouve en Afrique, nulle mention n'est faite du pays où il pose un instant ses bagages, comme si le Continent Noir était un seul et même pays. Cousin lointain (ou pas) de Tintin, Hector, psychiatre autant que son modèle était journaliste, court d'un pays à l'autre sans grand souci de vraisemblance.
On pourrait aussi tiquer sur le choix des destinations d'Hector : atterrissant en Chine sans aucun problème, il se rend directement au Népal, par exemple. Quand on connaît la situation entre ces deux nations, on peut s'interroger : une étape de transition, dans le scénario, aurait été nécessaire, si vous voulez mon avis. De la même façon, lorsqu'Hector se retrouve en Afrique, nulle mention n'est faite du pays où il pose un instant ses bagages, comme si le Continent Noir était un seul et même pays. Cousin lointain (ou pas) de Tintin, Hector, psychiatre autant que son modèle était journaliste, court d'un pays à l'autre sans grand souci de vraisemblance.Heureusement, il y a, pour sauver ce film, les interprètes et, à leur tête, un Simon Pegg à mille lieues de ses pitreries de la trilogie Cornetto. A lui seul, il sauve "Hector et la recherche du bonheur" du naufrage auquel le condamnaient sa réalisation et son scénario. On goûtera (ou pas) les prestations de Rosamund Pike (dont le personnage est assez inconstant et inconsistant), de Jean Reno et de Toni Collette (toujours aussi talentueuse), pour ne nommer qu'eux.
L'intention première du film était sans doute louable, mais sa maladresse, notamment en ce qui concerne sa réalisation et son approche des personnages, dont la psychologie est traitée sans finesse. On aurait aimé faire un joli voyage en compagnie d'Hector, mais la ballade qu'il fait autour du monde à la recherche du bonheur tourne en rond et pourra laisser le spectateur sur le bord de la route. Avec moins de maladresses, nul doute que le périple de ce drôle de psychiatre aurait pu donner un film moins oubliable.

















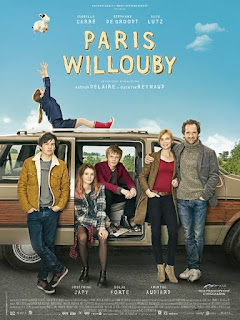















.jpg)



